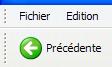|
«Mais
pourquoi y a-t-il autant de chiens dans votre film?» Impossible
d’y couper, la question revient toujours dans la bouche des
journalistes et celle des spectateurs. Ce soir-là encore, à
Montpellier, où était organisée la première séance publique
après la présentation du film à Cannes, Jonathan Nossiter y a
eu droit. La salle de 350places était comble, plusieurs dizaines
de personnes n’avaient pas pu entrer. Tous ces gens pour un film
sur le vin? Il est vrai que la région s’y prête, et parmi les
spectateurs se trouvaient nombre de viticulteurs et d’étudiants
en œnologie. Mais il faut dire surtout qu’en questionnant le
monde du vin sur trois continents Nossiter a ouvert une porte sur
quelques-uns des problèmes majeurs de ce temps, de ceux qui
concernent tout le monde, tous les jours, à tous moments. Une
affaire de goût? Oui, justement. Mais s’agit-il de votre goût,
vraiment, ou de celui que le marché vous impose?
Hubert de Montille, propriétaire et viticulteur bourguignon, est
une des vedettes de «Mondovino», pas uniquement parce que son crâne
déplumé apparaît sur l’affiche du film. Une de ses phrases
peut servir de première clé: «Où
il y a de la vigne, il y a de la civilisation, il n’y a pas de
barbarie.» Jonathan Nossiter est allé voir là où il
y a de la vigne, au Brésil et en Sardaigne, en Bourgogne et en
Argentine, dans le Bordelais et en Californie. Voir, et écouter
ce que les gens ont à dire. Et pour qu’ils s’expriment, ces
gens, il est entré chez eux le sourire aux lèvres, on le voit
dans le film, accompagné seulement de deux complices, la
photographe Stéphanie Pommez et un cinéaste uruguayen vivant à
Paris, Juan Pittaluga: «Ceux
qui nous recevaient ne voyaient pas débarquer une équipe de cinéma
ou de télévision, mais trois copains avec lesquels ils pouvaient
parler tout en continuant de se promener dans leurs vignes ou de
goûter leur vin.» Deux complices qui ne s’intéressent
pas particulièrement au vin, c’est ce qu’il souhaitait, parce
qu’il voulait que le film ne se limite pas aux connaisseurs et
amateurs de la chose: «Quand
Juan tenait la caméra, comme il se fiche du vin, son regard se
portait sur les à-côtés, grâce à lui j’ai vu ensuite des
choses que je n’aurais pas remarquées.» Un
chauffeur qui attend son maître, un ouvrier sur son échelle, des
mains de filles qui se tordent tandis qu’on célèbre les noces
de la Californie et du Bordelais, ces arrière-plans irriguent le
film, fondent son humanité. La plupart du temps, cependant,
Jonathan Nossiter tenait lui-même la caméra, comme une troisième
casquette vissée sur la tête, avec celle du réalisateur et du
sommelier. Au départ, il prévoyait deux mois de tournage et un
de montage, finalement trois années ont passé.
Quelle
impression a-t-il rapporté de l’aventure, lui demande une
spectatrice? «On trouve chez
les vignerons ce qu’il y a de plus beau chez les grands
artistes, la prétention en moins.» Le temps, en
effet, se charge de dégonfler les têtes. Le temps qui passe et
le temps qu’il fait. Le soleil qui brille au mauvais moment, la
pluie qui tombe quand il ne faudrait pas, le gel qui fiche tout en
l’air, la vanité ne tarde pas à en prendre un coup. Le vin
comme une école de l’humilité. Le ciel ne se soucie pas de
l’orgueil des hommes et se moque de leurs besoins d’argent.
Mais quand il y a beaucoup à gagner? Là, cela devient autre
chose, le vin ne peut être la seule marchandise qui se dérobe
aux impératifs du marché, il faut que sa qualité soit
constante, il faut qu’il séduise, chaque année, qu’il neige
ou qu’il pleuve, que la récolte soit abondante ou maigre, on ne
plaisante pas avec le business. D’où le mot de l’importateur
new-yorkais Neal Rosenthal, qui parle d’une «guerre
entre résistants et collaborateurs». Résistance et
collaboration, le film s’organise autour de ces deux pôles.
Jonathan Nossiter: «Le vin,
c’est l’histoire qui vit, qui respire, en relation constante
avec le passé, celui du terroir, celui de cette bouteille elle-même,
un passé qui continue de vivre au présent, voire qui s’améliore
avec le temps. C’est un des liens essentiels qui nous restent
avec notre propre histoire. En cela, le vin est progressiste et
notre histoire est menacée par l’acte commercial envisagé
comme unique raison d’être.»
Il a rencontré Michel Rolland, œnologue consultant de
plusieurs centaines de vignerons de par le monde, Bordeaux,
Californie, Argentine, Maroc, Inde, entre autres. L’homme qui «micro-bulle»
à tour de bras (c’est son truc), se marre tout le temps et
professe que l’on peut faire du vin partout. Le cinéaste l’a
filmé dans sa voiture, dans son bureau, dans son labo. Pas dans
les vignes? «Non, j’ai passé
six heures avec lui, je n’ai pas choisi les lieux. Avec Aimé
Guibert (autre vigneron, autre vedette du film), je
n’ai passé que deux heures, dans ses vignes.» Michel
Rolland est un ami de Robert Parker, le critique qui pour quelques
points de plus ou de moins (il note les vins sur 100) fait la
fortune d’un vigneron ou décide de sa ruine. Dans le Bordelais
et la vallée du Rhône, on lui élèverait volontiers une statue,
il la mérite. Mais aujourd’hui, son jugement fait loi, ce
n’est plus une affaire de goût, c’est une question de pouvoir
et d’argent. Et pour lui plaire, certains vignerons ont cessé
de faire le vin qu’ils aimaient, celui de leur terroir, pour
fabriquer celui que Parker aime. Quand Mondavi, qui règne sur le
vin de Californie et sur quelques-uns des beaux crus de par le
monde, rachète un vignoble toscan, les critiques américains décrètent
d’un même élan que le vin produit est «le
meilleur au monde», et si dans le même temps Parker
lui attribue 100 sur 100 (cela peut arriver, c’est peut-être un
hasard), le prix de la bouteille est multiplié par 100. Limpide.
Le même vin, partout, chaque année, on y vient. Comme le Coca.
Comme les McDo. Tout le monde aime la même chose, tout le monde
est d’accord. Ce que Hollywood a réussi en un peu plus d’un
siècle, la Californie du vin et ses alliés sont en passe de le réaliser
en moins de vingt ans. Très fort.
Face aux puissants, des culs-terreux, des attardés, des rétrogrades,
c’est ainsi que les désignent ceux qui prétendent vivre avec
leur temps. Ce n’est pas si simple, et dans «Mondovino» il
n’y a ni bons ni méchants, ou du moins la distinction
n’est-elle pas si tranchée. Aimé Guibert, qui a parcouru pour
l’occasion les 30 kilomètres qui séparent ses vignes
d’Aniane de Montpellier: «Sous
Franco, il existait plusieurs catégories de criminels politiques
et Nossiter me paraît correspondre à l’une d’elles: il est
un anarchiste modéré.» Dans «Mondovino» comme chez
Renoir, le problème est que tout le monde a ses raisons. Celles
d’Hubert de Montille et de ses enfants, la jolie Alix en tête,
ne sont pas celles du marché. Les vins dont on nous dit qu’ils
sont meilleurs, ceux qui plaisent, donc, «vous
bluffent, vous en mettent plein la gueule dès le départ et vous
lâchent d’un seul coup, et alors il n’y a plus rien». La
conclusion d’Hubert de Montille, dans le film: «Le
monde moderne, parce qu’il n’a plus le temps de rien, est
habitué à cela, il aime se faire bluffer.» Des vins
bourrés d’effets spéciaux, si l’on veut. Aimé Guibert le
dit autrement, mais cela revient au même: «Soyons
clairs, le vin est mort. Et pas seulement les vins, mais aussi les
fruits, les fromages…» Le bonhomme joue volontiers
les provocateurs, en tout cas il continue de faire comme il
l’entend, attaché à ce «métier
de poète» qui consiste à élever de grands vins. Le
mystère n’est pas près de se dissiper, qui dure depuis aussi
longtemps que la civilisation et que des milliers de gens dans le
monde cultivent.
On dira peut-être qu’il y en a pour tous les goûts, des vins
à l’épate, des grands, des bons et même d’infâmes
piquettes. Oui, mais… «Souvenez-vous
qu’aux jeux Olympiques d’Athènes, une seule boisson était
autorisée: Coca-Cola. Toutes les autres étaient interdites!», tempête
Aimé Guibert. Pas si loin de là, un vigneron sarde rappelle que «même
les animaux choisissent ce qu’ils mangent».
Les clebs courent dans les vignes derrière leur maître.
Ils sont les veilleurs, les gardiens, comme des totems, la truffe
au ras des grappes. Allez savoir si le vin serait le même si
parfois ils ne levaient pas la patte sur les ceps. Robert Parker,
lui aussi, a des chiens. L’un d’eux est pétomane.
«Mondovino», de Jonathan
Nossiter. En salles le 3 novembre.
Jonathan Nossiter, né
aux Etats-Unis il y a 42 ans, cinéaste et documentariste, a réalisé
notamment «Sunday»,«Resident Alien» et «Signs and Wonders».
Pascal
Mérigeau
Pascal
Mérigeau est journaliste et critique de cinéma au "Nouvel
observateur"
|